
Le système solaire
1 - (très) Petite histoire de l'univers
Les astronomes admettent (il n'y avait personne pour faire le reportage de cet évènement) que notre univers a commencé il y a environ 15 milliards d'années par une gigantesque explosion : le "BIG BANG".
Un millième de seconde après le début de l'univers, apparaissent les protons et les neutrons.
Plus tard, ces protons et ces neutrons s'assemblent pour former des noyaux atomiques et capturent des électrons pour former des atomes.
A ce moment, l'univers est un énorme nuage ne contenant que des atomes d'hydrogène et d'hélium.
Un million d'années plus tard, sous l'action de la force de gravité (chaque objet attire tous les autres et est attiré par tous), ce nuage se fragmente, il forme des "grumeaux" qui deviendront des galaxies.
L'un de ces grumeaux deviendra notre galaxie que l'on peut observer lorsque le ciel de nuit est très clair : la voie lactée.
A l'intérieur de ces grumeaux, de "petits" nuages d'atomes d'hydrogène et d'hélium se forment.
Toujours sous l'action de la gravité, certains de ces petits nuages se condensent. A l'intérieur, la température augmente, une nouvelle réaction se déclenche produisant une énorme quantité d'énergie : les premières étoiles sont nées.
Au cœur de l'étoile, les atomes d'hydrogène fusionnent pour produire des atomes d'hélium (et quelques autres sortes atomes) : c'est la fusion thermonucléaire que l'homme sait reproduire de manière brutale (bombe H) et qu'il cherche à maîtriser de façon contrôlée pour produire de l'énergie électrique. Petit à petit (un à quelques milliard d'années), le stock d'hydrogène disponible dans l'étoile s'épuise. A la fin, faute de "carburant", la réaction s'arrête, l'étoile s'effondre sur elle même, la température augmente de nouveau. Une nouvelle série de réactions thermonucléaires s'enclenche, très brutalement, produisant rapidement (quelques jours) de nouvelles espèces atomiques. Sous la pression énorme engendrée par ces réactions, l'étoile explose et devient une supernova. Elle devient alors des milliers de fois plus brillante, jusqu'a être parfois visible en plein jour.

Apparition d'une étoile nouvelle, observée par Tycho BRAHE en 1572
extrait de l'Astronomie Populaire de Camille FLAMARION, le premier auteur de livres d'astronomie pour le grand public.
Environ la moitié de la matière qui compose l'étoile est éjectée sous formes de poussières qui vont voyager dans l'espace et être capturées par d'autre nuages qui ne se sont pas encore transformés en étoiles. Ces nuages contiendront donc des atomes de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer, d'or et de tous les autres atomes que nous connaissons sur terre (et qui forment notre corps). C'est le cas du nuage qui va devenir, il y a environ 5 milliards d'années, une petite étoile particulièrement importante pour nous : le SOLEIL.
Nous sommes donc, comme le dit joliment Hubert REEVES, des "poussières d'étoiles"
Ceux qui voudraient aller plus loin dans la découverte de l'histoire de l'univers (notre histoire) pourront lire "POUSSIERES d'ÉTOILES d'Hubert REEVES (Éditions du Seuil).
2 - Le système solaire
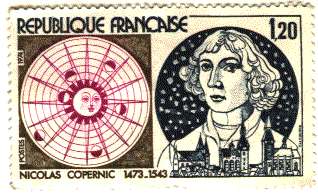
Le nuage qui allait devenir le soleil et l'ensemble du système solaire contenait donc des atomes d'hydrogène et d'hélium datant du début de l'univers, mais aussi d'autres atomes formés dans d'autres étoiles ayant fonctionné auparavant. Lors de la phase de concentration de ce nuage qui comme tout dans l'univers tournait sur lui-même, les différents composants triés par la force centrifuge (comme dans une essoreuse à salade) se sont assemblés en paquets :
Au centre, la plus grande partie du nuage se rassemble pour former une boule de gaz qui deviendra le soleil.
Autour, de petits paquets de poussières et de gaz s'agglomèrent pour former de petites sphères qui vont devenir les planètes.
Les différents composants du système solaire :
Le soleil :
C'est une petite étoile (les astronomes la classent dans la série des étoiles naines jaunes) qui a environ 5 milliard d'années. Elle a utilisé la moitié de son combustible nucléaire (l'hydrogène).
Diamètre : 1 391 000 km (109 fois celui de la Terre)
Masse : 2 x 1030 kg (330 000 fois celle de la Terre)
Température : surface 6000° C, cœur 15 000 000°C
Rotation : 25 jours à l'équateur, 34 jours aux pôles
Les planètes (en partant du soleil)
| Nom | Diamètre (km) | Distance au soleil (km) | Rotation sur elle même | Révolution autour du soleil |
| Mercure | 4878 | 58 000 000 | 58j 15h | 87,97 j |
| Venus | 12 102 | 108 000 000 | 243 j | 224,7 j |
| Terre | 12 756 | 150 000 000 | 1 j | 365,25 j |
| Mars | 6 760 | 227 940 000 | 24h 37min | 686,98 j |
| Jupiter | 142 796 | 778 300 000 | 9h 50 min | 11 ans 314,8 j |
| Saturne | 120 660 | 1 429 400 000 | 10h 14min | 29 ans 167 j |
| Uranus | 50 800 | 2 875 000 000 | 15h 30min | 84 ans 7,4 j |
| Neptune | 48 600 | 4 504 000 000 | 15h 50min | 164 ans 280 j |
Réunis en assemblée générale depuis le 14 août 2006 à
Prague, les 2 500 astronomes de l'Union astronomique internationale (UAI) ont décidé
par un vote à main levée de reléguer Pluton dans une nouvelle catégorie :
celle des «planètes naines» en compagnie de Cérès, un gros astéroïde
d'un peu de moins de
| Pluton | 2300 | 5 900 000 000 | 6j 9h 18min | 248 ans 249 j |
La Terre, comme d'autres planètes a un satellite : la Lune
Diamètre : 3476 km
Distance à la terre : 384 400 km
Rotation sur elle- même identique à celle de la révolution autour de la Terre, ce qui explique que nous voyons toujours la même "face". Cette égalité du "jour lunaire" et de "l'année lunaire" est due à l'attraction de la Terre.
Révolution sidérale (retour à la même position dans le ciel par rapport aux étoiles) :
27 j 7 h 46 min 11,5 s
Révolution synodique (retour à la même position dans le ciel par rapport au soleil) = durée de la lunaison : 29 j 12 h 44 min 2,8 s. Cette durée est un peu plus longue que la révolution sidérale car pendant que la Lune tourne autour de la Terre, le système Terre-Lune tourne autour du Soleil. Les mois de notre calendrier viennent de cette durée, la lunaison, puis ont été modifiés (28, 29, 30 ou 31 jours) pour que l'année coïncide avec les 12 mois.

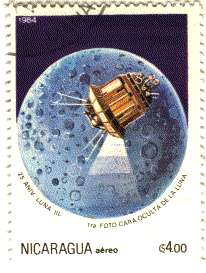
Autres corps du système solaire :
Dans la zone entre Mars et Jupiter se trouvent des milliers de petits objets qui ne se sont pas assemblés pour former une planète ; ils forment la ceinture des astéroïdes. Parfois, l'un d'entre eux, déstabilisé par les attractions des planètes, s'échappe de son orbite et finit par percuter un autre corps du système solaire. C'est comme cela que se sont formés les cratères d'impact que l'on voit par exemple sur la Lune ou sur Mars. Il en existe aussi sur Terre, mais sauf pour les plus récents (Météor Crater dans l'Arizona par exemple, du à l'impact d'un petit astéroïde il y a 24000 ans), ils sont peu visibles car l'érosion les efface petit à petit.
Au delà de Pluton, les astronomes pensent qu'il existe une zone, le nuage de Oort où se trouvent des boules de glace et de poussières, restes du nuage primitif. Lorsque l'une de ces boules, quittant son orbite sous l'effet de l'attraction des grosses planètes, plonge vers le Soleil une partie de la glace se sublime (c'est à dire se transforme en gaz) et forme une queue éclairée par le Soleil : la boule de glace est devenue une comète. En fonction de leur trajectoire de départ, certaines passent une fois à proximité du Soleil puis se perdent dans l'espace hors du système solaire. D'autres, qui prennent une trajectoire elliptique, reviennent régulièrement. Le premier à avoir compris cela fut l'astronome anglais Edmund Halley. Ce dernier calcula, en utilisant la théorie de la gravitation d'Isaac Newton, l'orbite de la comète brillante apparue en 1682 ; il détermina la périodicité de ses passages à l'intérieur du Système solaire et donc les dates passées et futures de ces passages. Le retour de la comète en décembre 1758 lui donna raison.

La comète de Halley représentée sur la Tapisserie de Bayeux (24 avril 1066)
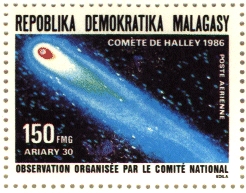
Si l'on s'éloigne encore du Soleil, on quitte le système solaire. Il faudra voyager longtemps pour se trouver à proximité de notre plus proche voisine : l'étoile Proxima du Centaure à 40 000 000 000 000 km du Soleil.
Le km, multiple usuel du m sur Terre pour mesurer des distances n'est pas adapté aux distances intersidérales. On préfère utiliser l'Année-Lumière (AL) qui correspond à la distance parcourue par la lumière en un an
1 AL = 300 000 x 3600 x 24 x 365,25 = 9 467 300 000 000 km
300 000 distance en km parcourue par la lumière en 1 seconde
x 3 600 nombre de secondes en une heure
x 24 nombre d'heures en 1 jour
x 365,25 nombre de jours en un an
_____________
9 467 300 000 000 km soit environ 10 000 milliards de km ( 1013 km )
Proxima du Centaure se trouve à 4,2 AL de la Terre, c'est à dire que la lumière émise par cette étoile met un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Par comparaison, la lumière met un peu plus d'une seconde pour faire le trajet Lune-Terre et 8 minutes 30 secondes pour venir du Soleil jusqu'a nous. L'étoile Polaire est à 650 AL de nous, ce qui veut dire que, en la regardant, nous voyons de la lumière émise il y a 650 ans.
Notre galaxie, qui regroupe quelques milliards d'étoiles mesure environ 100 000 AL de diamètre et 10 000 AL d'épaisseur. Au delà se encore trouvent d'autres galaxies.

Les objets les plus lointains que les astronomes ont pu observer se trouvent aux confins de l'univers observable : environ 10 milliards d'AL.